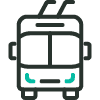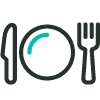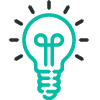Culture et arts Nicaragua
Drôle de contrée que le Nicaragua, coupé en deux par les cordillères centrales, sans liens physiques, ou presque, entre ses deux pans : mestizo (métisse) et surpeuplé dans les deux tiers ouest (où réside 90 % de la population) ; noir, créole, amérindien et dépeuplé dans les forêts pluvieuses et les lagunes de l’est.
Cette scission, autant culturelle que géographique, remonte aux XVIIe-XVIIIe siècles, lorsque la zone caribéenne de l’Amérique centrale fut colonisée par les Britanniques. Leur présence passée se lit encore sur les cartes : Bluefields, Monkey Point, Pearl Lagoon, Coconut Point, Sandy Bay... Les flibustiers anglais s’installèrent sur cette côte hostile pour mieux attaquer Granada et ses trésors, tandis que des esclaves noirs des îles antillaises furent déportés pour travailler à l’extraction des bois précieux. Ils y ont fait souche.
Fresques
Le muralisme, né dans le Mexique révolutionnaire des années 1930, s’est largement propagé au Nicaragua sous l’égide sandiniste. Une école, organisée avec l’aide de volontaires italiens et adjointe au ministère de la culture, a même œuvré durant plusieurs années (1982-89) à former des artistes à la technique. Dénonçant pêle-mêle Somoza et son allié américain, la colonisation, l’exploitation du peuple, la soumission à la religion, des centaines de fresques politiques ont couvert les murs des villes durant une décennie.
Réalisées par des Nicaraguayens ou des membres des brigades internationales, les fresques appelaient à la révolution constante, à une égalité des droits, à de meilleurs traitements des femmes. Elles chantaient le peuple réveillé à la lecture de Marx, sa gratitude pour les politiques sociales et de santé, les martyrs de la cause... Une vraie propagande artistique, souvent réalisée par des peintres de talent.
Après la chute du régime sandiniste en 1990, un grand nombre de ces fresques ont été détruites, en particulier à Managua sous l’administration de l’ultralibéral Arnoldo Alemán. On peut heureusement encore en voir certaines à León (près de la cathédrale) et, dans une moindre mesure, à Estelí. Quant au célèbre cycle de fresques de l’église Santa María de los Angeles, à Managua, réalisées en 1982-85 sous la direction du peintre italien (et internationaliste) Sergio Michilini il a subi des altérations notables. Comptant l’histoire du pays depuis l’époque précolombienne, vue par les yeux des adeptes de la théologie de la libération, il s’achève sur une résurrection révolutionnaire...
Rubén Darío
« L’enfant poète » : c’est ainsi que les Nicaraguayens ont appris à connaître l'un des plus grands écrivains du pays, à la suite de la publication d’un poème dans un journal de la petite ville de Rivas. Il n’avait que 13 ans. Remarqué par les plus hautes autorités de l’État, il bénéficia peu après d’une bourse pour aller étudier en Europe... mais il la vit commuée en bourse pour Granada par le président de la République de l’époque, qui s’inquiétait déjà de ses écrits séditieux remettant en cause Nation et religion !
Voyageant fréquemment en Amérique Latine, Rubén Darío était à Valparaíso, au Chili, lorsqu’il publia en 1888, à l’âge de 21 ans, l’un de ses chefs-d’œuvre poétiques, Azul (Azur). Marié en 1890, veuf en 1893, il sombra dans l’alcool, se remaria, puis fut nommé consul à Buenos Aires, découvrit New York, puis Paris, qui le déçut - tout autant que Verlaine, qu’il rencontra. Renvoyé de la diplomatie, il devint correspondant de plusieurs journaux, voyagea dans toute l’Europe.
Il publia en 1896 Proses profanes, premier manifeste moderniste, à l’extraordinaire liberté de ton, puis Chants de vie et d’espérance (1905). Musicalité, versification moins figée, plus riche, presque libre parfois, mélancolie, symbolisme, élans mystiques et païens en parallèle identifient son œuvre. Celle-ci fut célébrée pour avoir permis le rapprochement des poésies française et latino-américaine.
Rubén Darío est mort en 1916 à León à la suite d’une opération. Idolâtré dans son pays, il a donné son nom à sa ville natale (Ciudad Darío, ex-Metapa), renommée en son honneur, et à une multitude de rues et de lycées.
Élément fondateur de la littérature nicaraguayenne, El Güegüense (Macho Ratón) est une pièce en partie dansée remontant au XVIe ou XVIIe siècle. Cette œuvre anonyme, rédigée en espagnol et en náhuatl, mais surtout transmise oralement, met en scène le Nicaragua colonial de l’époque, et plus particulièrement un personnage satirique (le Güegüense), symbole des opprimés astucieux et irrévérencieux en prise avec les autorités.
Le thème même de la pièce, la représentation de la résistance à la colonisation, en fait la première œuvre littéraire de contestation au Nouveau Monde - une spécificité qui l’a vue classée en 2005 au Patrimoine mondial de l’Unesco dans le domaine des « œuvres immatérielles ». Une sorte de manifeste de l’âme nicaraguayenne insoumise, en quelque sorte...
El Güegüense doit aussi une partie de son intérêt à la manière dont ses 14 tableaux mêlent traditions musicales et artistiques espagnole et amérindienne. On peut le voir jouer durant les fêtes patronales de Diriamba (Pueblos Blancos) au mois de janvier.
Infos pratiques Nicaragua
Bons plans voyage Nicaragua
Les événements Nicaragua
Forum Culture et arts Nicaragua
Photos Nicaragua